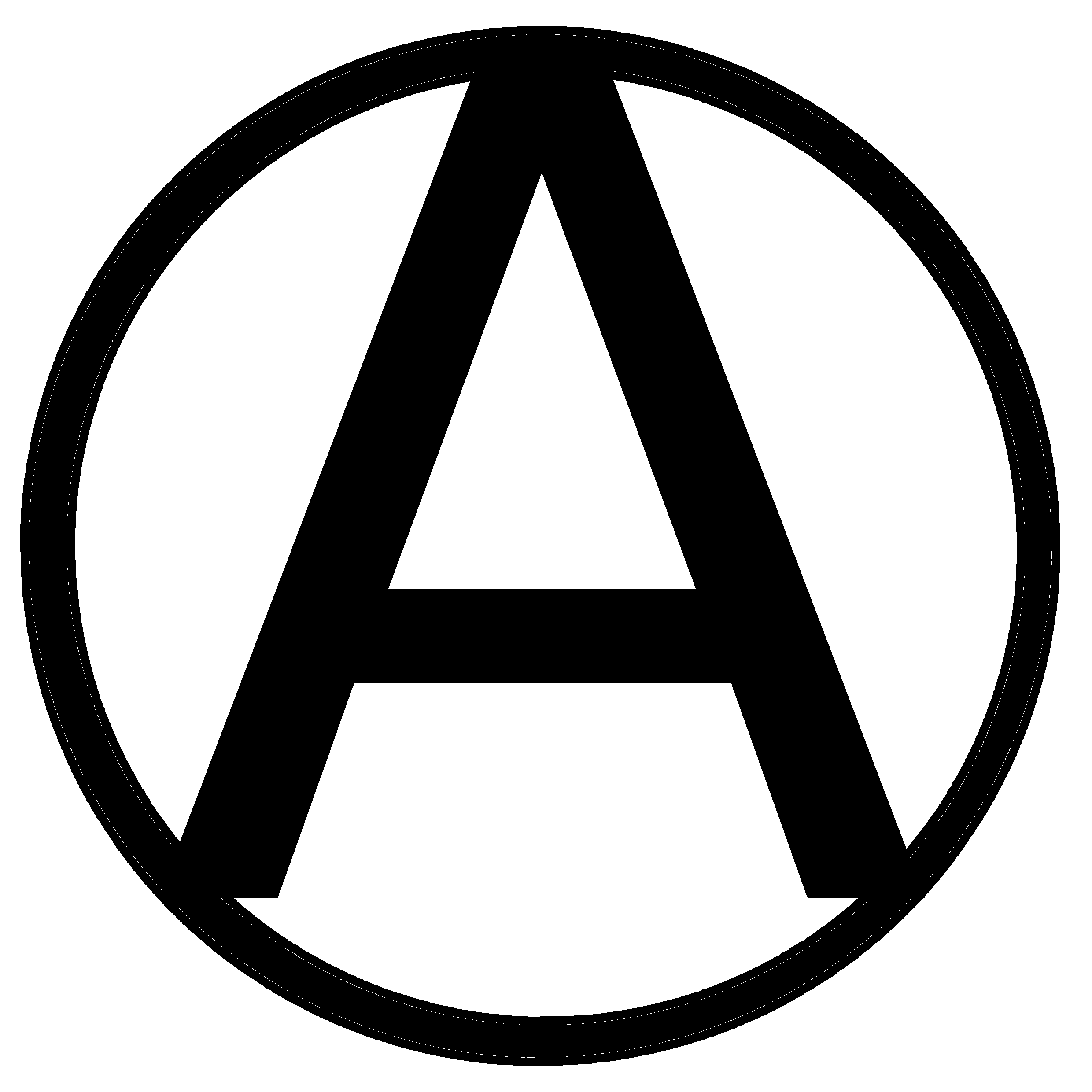
C.1 Qu'est-ce qui détermine le prix dans le capitalisme ?
Les défenseurs du capitalisme sont habituellement d’accord sur ce qui s’appelle la théorie subjective de la valeur (STV), comme expliqué par la plupart des manuels économiques traditionnels. Ce système des sciences économiques se nomme habituellement les sciences économiques "marginalistes", pour les raisons qui deviendront claires.
En un mot, le STV énonce que le prix d’un produit est déterminé par son utilité marginale pour le consommateur et le producteur. L’utilité marginale est le point, sur l’échelle de la satisfaction d’un individu, à laquelle son désir pour un bien est satisfait. Par conséquent le prix est le résultat de différentes évaluations subjectives sur le marché. On peut facilement voir pourquoi cette théorie pourrait interpeller ceux qui sont intéressés par la liberté individuelle.
Cependant, le STV est un mythe. Comme la plupart des mythes, il y a une part de vérité en lui. Mais comme explication de la façon dont est déterminé le prix d’un produit, il a de sérieuses failles.
La part de vérité est que des individus, groupes, compagnies, etc. évaluent en effet des marchandises et les consoment ou les produisent. Le taux de consommation, par exemple, est basé sur valeur d’usage des marchandises pour les utilisateurs (bien que les raisons pour lesquelles un consommateur achète un produit sont affectées par des considérations des prix et de revenu, comme nous le verrons). De même, la production est déterminée par l’utilité que producteur pense avoir à fournir plus de marchandises. La valeur d’usage d’un bien est une évaluation fortement subjective, et ainsi change au cas par cas, selon les goûts de l’individu et ses besoins. En tant que tel elle a un effet sur le prix, comme nous le montrerons, mais en tant que moyen de déterminer le prix d’un produit, elle ignore la dynamique d’une économie capitaliste et les relations de production qui sont à la base du marché. En effet, le STV traite tous les produits, comme les oeuvres d’art, et de tels produits de l’activité humaine (à cause de leur unicité) ne sont pas des produits capitalistes dans le sens habituel du mot (c.-à -d. ils ne peuvent pas être reproduits et ainsi le travail ne peut pas augmenter leur quantité). Par conséquent le STV ignore la nature de la production sous le capitalisme. C’est ce qui sera abordé dans les sections suivantes.
Naturellement, les économistes modernes dépeignent et tentent de considérer les sciences économiques comme un "science de de la valeur." Naturellement, il ne leur vient pas à l’esprit qu’ils prennent habituellement les structures sociales existantes et les dogmes économiques construits autour d’eux pour prendre pour acquis et ainsi les justifier. Comme l’a précisé Kropotkin :
"Toutes les prétendues lois et théories d’économie politique ne sont en réalité pas plus que des rapports de la nature suivante :
’En considérant qu’il y a toujours dans un pays un nombre considérable de personnes qui ne peuvent pas subsister un mois, ou même une quinzaine, sans accepter les conditions du travail que leur impose l’état, ou offerts à eux par ceux que l’état identifie comme les propriétaires de la terre, des usines, des chemins de fer, etc., les résultats seront connus d’avance.’
"Jusqu’ici l’économie politique de classe moyenne a été seulement une énumération de ce qui se produit dans les conditions sus-mentionnées — sans énoncer distinctement les conditions elles-mêmes. Et puis, après avoir décrit les faits qui surgissent dans notre société dans ces conditions, ils représentent à nous ces faits en tant que lois économiques rigides et inévitables." [Kropotkin’s Revolutionary Pamphlets, p. 179]
En d’autres termes, les économistes prennent habituellement en comptes les aspects politiques et economique de la société capitaliste (tels que des droits de propriété, l’inégalité, et ainsi de suite) comme etant donnés et construisent leurs théories autour d’eux. Le marginalisme, en effet, a sorti la "politique" de "l’économie politique" en prenant la société de capitaliste comme un fait immuable, avec son système de classe, ses hiérarchies et ses inégalités. En se concentrant sur différents choix individuels, ils ont abstrait le système social dans lequel de tels choix sont faits et ce qui les influencent. En effet, le STV a été construit en sortant des individus de leurs environnements sociaux et en produisant des "lois" économiques applicables pour tous les individus, dans toutes les sociétés, au travers du temps. Ceci a comme conséquence que tous les exemples concrets, peu importe s’ils sont historiquement différent, sont traités comme expressions du même concept universel. Ainsi, dans les sciences économiques néoclassiques, le travail salarié devient travail, le capital devient moyen de production, le processus de travail devient une fonction de production, le comportement de thésaurisation devient la nature humaine. De cette façon l’unicité de la société contemporaine, à savoir son influence sur le salaire du travail, est ignorée ("la période par lequel nous passons. . . est distinguée par une caractéristique spéciale — LES SALAIRES."[Proudhon, System of Economical Contradictions, p. 199]) et ce qui est spécifique au capitalisme est universalisé et rendu applicable eternellement. Une telle perspective ne peut s’empêcher d’être idéologique plutôt que scientifique. En essayant de créer une théorie applicable eternellement (et ainsi, apparemment, independant de la valeur) ils cachent juste le fait que leurs théories justifient les inégalités du capitalisme. Comme Edward Herman le précise :
"En 1849, l’économiste anglais Nassau Senior a qualifié les syndicats défenseurs et les règlements de salaires minimum de ’sciences économiques des pauvres.’ L’idée que lui et ses confrères mettaient en avant des ’sciences économiques des riches’ ne lui est ait jamais venu a l’esprit ; il pensait à lui en tant que scientifique et porte-parole des véritables principes. Cet aveuglement a infiltré les sciences économiques traditionnelles jusqu’à la période de la révolution de Keynesienne des sciences économiques des années 30. Les sciences economiques Keynesiennes, cependant, ont été rapidement récupérée comme instrument au service de l’état de capitaliste, dérangeait dans son instance à souligner l’instabilité inhérente du capitalisme, la tendance au chômage chronique, et le besoin de l’intervention substantielle du gouvernement pour en maintenir la viabilité. Avec le capitalisme résurgent des 50 dernières années, les idées de Keynes, et leurs appels implicites pour l’intervention, ont été soumis à des attaques incessantes, et, dans la countre révolution intellectuelle menée par l’école de Chicago, les sciences économiques traditionnelles du laissez-faire (les ’let-the-fur-fly’) des riches ont été rétablies comme noyau des sciences économiques traditionnelles." [The Economics of the Rich]
Herman continue de se demander "Pourquoi les économistes sont-ils au service les riches ?" et argue du fait que "D’une part, les principaux économistes sont parmi les riches, et les autres cherchent à avoir ce type d’avancement. L’économiste Gary Becker de l’école de Chicago avait découvert quelque chose quand il a argué du fait que les motifs économiques expliquent beaucoup d’actions fréquemment attribuées à d’autres forces. Il n’a naturellement jamais appliqué cette idée aux sciences économiques en tant que profession..."[Ibid.] Il y a beaucoup de places bien payées pour les ’think tanks’ (NDT : réservoirs à pensées), des postes de chercheur, de consultants et ainsi de suite, qui créent "’une demande effective’ qui devrait obtenir une ressource appropriée d’approvisionnement." [Ibid.]
L’introduction du marginalism et de son acceptation en tant que l’"orthodoxie" a servi, et sert encore à présent, à détourner l’attention des questions les plus critiques auxquelles font face les travailleurs (par exemple, ce qui se passe dans la production, comment les relations d’autorité agissent dans la société et sur le lieu de travail). Plutôt que de regarder la façon dont des choses sont produites, les conflits produits dans le processus de production et la génération/division de l’excédent, le marginalisme a pris ce qui a été produit comme donné, de même que le lieu de travail capitaliste, la division du travail et les relations d’autorité et ainsi de suite.
Les théories peuvent chercher à décrire la vérité ou servir des droits acquis. Dans le deuxième cas, elles incorporeront seulement des concepts convenus pour atteindre les résultats désirés. Une théorie économique, par exemple, peut accentuer les bénéfices, les quantités de rendement, la quantité d’investissement, et les prix, et omet le pouvoir de lutte, d’aliénation, de hiérarchie et de négociation de classe. Alors la théorie servira des capitalistes, et, comme les capitalistes payent les salaires des économistes et dotent leurs universités, les économistes et leurs étudiants qui se conforment aux théories en bénéficieront aussi bien.
L’analyse d’équilibre générale et le marginalisme est faite aux ordres de la classe régnante. Le marginalisme ignore la question de la production et se concentre sur l’échange. Il argue du fait que n’importe quelle tentative des travailleurs pour améliorer leur position dans la société (comme, par exemple, les syndicats) est contre-productive, il prêche qu’"à la longue" chacun sera dans de meilleures conditions et qu’ainsi les problèmes de tout les jours ne sont pas pertinents (et n’importe quelle tentative d’y remédier, contre-productive) et, naturellement, que les capitalistes ont droit à leurs bénéfices, leurs paiements des intérêts et leurs loyers. L’utilité d’une telle théorie est évidente. Une théorie économique qui justifie l’inégalité, "prouve" que les bénéfices, les loyers et les intérêts n’ont pas le caractère d’exploitaion et arguent du fait que la puissance économique donnée aux mains de la classe regnante a ainsi plus de valeur d’emploi ("d’utilité"). Dans le marché des idées, c’est celles-ci qui satisferont la demande et deviendront intellectuellement "respectables."
Naturellement, tous les défenseurs des sciences économiques capitalistes ne sont pas riches (bien que la plupart désirent le devenir). Beaucoup croient en les affirmations suivant lesquelles le capitalisme est basé sur la liberté et que les bénéfices, les intérêts et les loyers représentent des "récompenses" pour des services fournis plutôt que des résultats de l’exploitation produite par des organisations de travail hiérarchiques et l’inégalité sociale. Cependant, avant d’aborder la question des bénéfices, des intérêts et des loyers nous devons d’abord expliquer pourquoi le STV est erroné.
C.1.1 Qu'y a-t'il alors de faux avec cette théorie ?
Le premier problème en employant l’utilité marginale pour déterminer le prix est que cela mène à un raisonnement circulaire. Les prix sont censés mesurer "l’utilité marginale" du produit, pourtant les consommateurs doivent savoir le prix d’abord afin d’évaluer comment mieux maximiser leur satisfaction. Donc la théorie subjective de la valeur "repose évidemment sur un raisonnement circulaire. Bien qu’elle essaye d’expliquer les prix, les prix [sont] nécessaires pour expliquer l’utilité marginale." [Paul Mattick, Economics, Politics and the Age of Inflation, p.58] En fin de compte, comme Jevons (un des fondateurs du marginalisme) l’a reconnu, le prix d’un produit est le seul indice qui nous permettent de déterminer l’utilité du produit au producteur. Étant donné que l’utilité de marginalité a été d’expliquer les prix, l’échec de la théorie ne pourrait pas être plus saisissant.
Deuxièmement, considérez la définition du prix d’équilibre. Le prix d’équilibre est le prix pour lequel la quantité exigée est avec précision égale à la quantité fournie. À un tel prix il n’y a aucune raison pour que les demandeurs ou les fournisseurs changent leur comportement. Pourquoi est-ce que ceci se produit ? La théorie subjective ne peut pas vraiment expliquer pourquoi ce prix est le prix d’équilibre, par opposition à tout autre. C’est parce que le STV ignore qu’une mesure objective est nécessaire aux évaluations "subjectives" sur le marché. Le consommateur, en faisant des emplettes, demande les prix afin d’affecter leur argent pour maximiser mieux leur "utilité" (et, naturellement, le consommateur constate les prix du marché, ce que la théorie de l’utilité marginale a été censée expliquer !). Et comment est-ce que une compagnie sait qu’elle fait un bénéfice à moins qu’elle compare le prix du marché aux coûts de production du produit en question ? Comme Proudhon l’a écrit, "si seule l’offre et la demande détermine la valeur, comment pouvons-nous dire ce qui est en trop et ce qui est suffisant ? Si ni le coût, ni le prix du marché, ni les salaires ne peuvent être mathématiquement déterminés, comment est-il possible de concevoir un excédent, un bénéfice ?" [System of Economical Contradictions, p. 114] Cette mesure objective peut seulement être le processus réel de la production dans le capitalisme, une production orientée vers le bénéfice. Les implications de ceci sont importantes comme l’on découvre ce qui détermine le prix dans le capitalisme, comme nous en discuteront dans la prochaine section (C.1.2 Alors qu’est-ce qui détermine le prix ?).
Les premiers marginalistes étaient conscients de ce problème et ont argués que le prix refléte l’utilité à la "marge" (Jevons, un des fondateurs de l’école marginaliste, énonça que "le degré final d’utilité détermine la valeur") ; Mais qu’est-ce qui détermine la position de la marge elle-même ? Ceci est fixé par l’offre disponible (l’"offre détermine le degré final d’utilité" — Jevons) ; Mais qu’est-ce qui détermine le niveau de l’offre ? (le "coût de production détermine l’offre" — Jevons). En d’autres termes, le prix dépend de l’utilité marginale, qui dépend de l’offre, qui dépend du coût de production. En d’autres termes, finalement sur une mesure objective (offre ou coût de production) plutôt que des évaluations subjectives ! Ceci n’est pas surprenant parce qu’avant que vous puissiez consommer ("évaluer subjectivement") quelque chose sur le marché, ce quelque chose doit être produit. C’est le processus de production qui réarrange la matière et l’énergie peu utile (pour nous) en des formes plus utiles. Ce qui nous amène directement de nouveau à la production et aux relations sociales qui existent dans une société donnée, — et les dangers politiques de définir la valeur (d’échange) en termes de travail (voir la prochaine section). Après tout, les individus ne rencontrent pas simplement une offre donné sur le marché, ils font également face à des prix, y compris les coûts liés à la production et à la réalisation de bénéfices.
Comme le but de la totalité du marginalisme était de faire abstraction de la production (où les relations de puissance apparaissent clairement) et de se concentrer sur l’échange (où ces mêmes relations interviennent indirectement), il n’est pas surprenant que la première théorie de valeur d’utilité marginale a été rapidement abandonnée. Les discours en rapport avec l’"utilité" dans les manuels de sciences économiques sont principalement heuristiques. D’abord les économistes néoclassiques ont employé "l’utilité" mesurable (cardinale, c.-à -d. qui était la même pour tous) mais cela a posé des problèmes politiques (parce que l’utilité cardinale impliquait que l’"utilité" d’un dollar supplémentaire à une personne pauvre était clairement plus grande que la perte d’un dollar pour un homme riche et ceci justifiaient évidemment des politiques de redistribution). Quand ceci a été identifié (en parralèle avec le fait évident que l’utilité cardinale était impossible dans la pratique) l’utilité est devenue "ordinale" (c.-à -d. l’utilité était une chose individuelle et ainsi ne pouvait pas être mesurée). Alors même l’utilité ordinale a été abandonnée car les utilités individuelles n’étaient pas comparables et ainsi des prix objectifs ne pouvaient pas être dérivés d’elles (Ce qui était l’argument d’Adam Smith et qui le mèna à développer une théorie de valeur de travail plutôt qu’une basée sur l’utilité, ou valeur d’utilisation). Avec l’abandon de l’utilité "ordinale", les sciences économiques traditionnelles ont cessé de penser aux préférences individuelles en ces termes. Ceci signifie que les sciences économiques modernes n’ont pas de théorie de la valeur du tout — et sans théorie de la valeur, les prétentions selon lesquelles les fonctionnements du capitalisme bénéficieront à tous ou que son résultat est la réalisation de toutes les préférences individuelles n’a aucune base rationnelle.
Ainsi la théorie de l’utilité a été graduellement privée de toute sa valeur et s’est réduit de l’utilité cardinale à l’utilité ordinale puis de l’utilité ordinale ’la préférence révélée.’ Cette retraite de l’utilité cardinale (qui était clairement une utopie) à l’utilité ordinale (distinction sans différence) puis à "la préférence révélée" (une pure tautologie — les consommateurs maximisent l’utilité totale comme le "révelent" les structures de la dépense ou, les consommateurs maximisent ce qu’ils maximisent) n’était qu’une des nombreuses retraites faites parmi celle que les marginalistes on du concédé alors que le noyau de conception de leurs théorie a été exposé à des questions simples mais précises.
Tout en ignorant la théorie "d’utilité" de la valeur, la plupart des sciences économiques traditionnelles acceptent les notions "de la concurrence parfaite" et (Walrasian) de l’"équilibre général" qui faisaient part et corps avec elle. Le marginalisme a essayé de montrer, dans les termes de Paul Ormerod, "que dans certaines conditions le système du marché libre mènerait à une attribution d’un ensemble donné de ressources ce qui était dans un sens très particulier et restreint optimal du point de vue de chaque individu et entreprise dans l’économie." [The Death of Economics, p. 45] C’était ce que la théorir de l’équilibre général de Walrasian a prouvé. Cependant, les conditions exigées s’avèrent quelque peu irréalistes (pour dire peu). Comme Ormerod le précise :
"Il ne peut pas être souligné trop fortement que ... le modèle concurrentiel est loin d’être une représentation raisonnable des économies occidentales dans la pratique ... [ c’est ] un déguisement de la réalité. Le monde ne consiste pas, par exemple, en un énorme nombre de petites sociétés, parmi lesquelles aucune n’a un quelconque degré de contrôle du marché ... La théorie présentée par la révolution marginaliste a été basée sur une série de postulats au sujet du comportement humain et des fonctionnements de l’économie. C’était pour beaucoup une expérience de raison pure, avec peu de rationalisation empirique des conditions."
En effet, "le poids de l’évidence" est "contre la validité du modèle de l’équilibre général concurrentiel comme une représentation plausible de réalité." [Op. Cit., p. 48, p. 62] Par exemple, l’oligopole et la compétition imparfaite ont été soustraites de sorte que la théorie ne permette pas de répondre aux questions intéressantes qui tournent autour de l’asymétrie d’information et de pouvoir de négociation parmi les agents économiques, que ce soit en raison de la taille, ou de l’organisation, ou des stigmates sociaux, ou de quoi que ce soit. Dans le monde réel, l’oligopole et l’asymétrie d’information sont communs et les pouvoirs de négociation sont la norme. Pour soustraire ces choses signifie présenter une vision économique en désaccord avec la réalité à laquelle les gens font face et pouvoir, en conséquence, seulement proposer des solutions qui nuisent à ceux qui ont des positions de négociation plus faibles et peu d’informations. En outre, le modèle est placé dans un environnement intemporel, avec des personnes et des entreprises travaillant dans un monde où elles ont la connaissance et des informations parfaites sur l’état du marché. Un monde sans futur et ainsi sans l’incertitude (n’importe quelle tentative d’inclure le temps, et ainsi l’incertitude, vous assure que le modèle cessera d’avoir un quelconque valeur). Ainsi le modèle ne peut pas facilement ou utilement expliquer la réalité dans laquelle les agents économiques ne savent pas réellement des choses telles que les futurs prix, la future disponibilité des marchandises, les changements dans les techniques de production ou des marchés devant se produire à l’avenir, etc... Au lieu de cela, pour réaliser son but — fournir des preuves au sujet des conditions d’équilibre — le modèle suppose que les acteurs ont la connaissance parfaite au moins des probabilités de tous les résultats possibles pour l’économie. En réalité, c’est l’inverse.
En ce monde intemporel et parfait, le capitalisme "du marché libre" se révelera une méthode efficace d’attribuer des ressources et tous les marchés s’éclairciront. En partie du moins, la théorie générale d’équilibre est une réponse abstraite à une question abstraite et importante : Une économie se fondant seulement sur des signaux des prix pour l’information du marché peut-elle être ordonnée ? La réponse de l’équilibre général est claire et définitive — on peut décrire une telle économie avec ces propriétés. Cependant, aucune économie réelle n’a été décrite et, donné les conditions impliquées, aucune économie semblable ne pourrait jamais exister. Un problème théorique a été résolu impliquant une certaine quantité d’accomplissement intellectuel, mais c’est une réponse qui n’a aucune incidence sur la réalité. Et ceci se nomme souvent "la grande théorie" de l’équilibre. Évidemment, la plupart des économistes doivent traiter le monde réel comme un cas spécial.
Ainsi la théorie générale d’équilibre analyse un état économique qui dont on a aucune raison de supposer qu’il surviendra, et qui n’est jamais survenu. C’est, donc, une abstraction qui n’a aucune applicabilité ou pertinence perceptible avec le monde tel qu’il est. Arguer du fait qu’il peut donner des vues théoriques utiles au monde réel est ridicule. Pendant que la théorie économique traditionnelle commence par des axiomes et des conditions initiales et emploie une méthodologie de deduction pour arriver aux conclusions, son utilité pour découvrir comment fonctionne le monde est limité. Premièrement, comme nous le notons dans la section F.1.3, la méthode déductive est pré-scientifique par nature. Deuxièmement, les axiomes et les conditions initiales peuvent être considérés irréels (car ils ont une pertinence empirique négligeable) et les conclusions des modèles de deductiviste peuvent seulement avoir de la pertinence avec la structure de ces modèles car ces modèles eux-mêmes n’ont aucun rapport avec la réalité économique. Tandis qu’il est vrai qu’il y ait certains problèmes intellectuels imaginaires pour lesquels le modèle général d’équilibre est bien conçu pour fournir des réponses précises (si quelque chose le peut vraiment), dans la pratique ceci signifie exactement pareil que dire que si on insiste pour analyser un problème qui n’a aucun vrai équivalent ou solution dans le monde réel, il peut être approprié d’employer un modèle qui n’a aucune application réelle. Les modèles dérivés pour fournir des réponses aux problèmes imaginaires seront peu convenables pour résoudre des problèmes économiques pratiques et réels ou même fournir des vues utiles dans la façon dont le capitalisme fonctionne et se développe. Dans les termes de l’économiste de gauche Nicholas Kaldor, la "théorie d’équilibre a atteint l’étape où le théoricien pur, avec succès (cependant peut-être par distraction), a démontré que les implications principales de cette théorie ne peuvent probablement pas se tenir en réalité, mais n’est pas encore parvenu à passer son message en clair à l’auteur du manuel et à la salle de classe." Il est peu surprenant, alors, que son "objection de base à la théorie d’équilibre général n’est pas que c’est abstrait — toute la théorie est abstraite et il doit nécessairement en être ainsi puisqu’il ne peut y avoir aucune analyse sans abstraction — mais qu’elle commence à partir du mauvais type d’abstraction, et donc donne un ’paradigme’ trompeur ... du monde tel qu’il est ; il donne une apparence trompeuse de la nature et des formes de l’opération des forces économiques." [The Essential Kaldor, p. 377 and p. 399]
Il y a une notion néoclassique plus réaliste de l’équilibre, appelée théorie "partielle" de l’équilibre (développée par Alfred Marshall). Le "temps" y est inclus par Alfred Marshall, via la notion que l’équilibre peut exister dans diverses formes. Les plus importants des concepts de Marshall sont l’équilibre de "court terme" et l’équilibre "de longue durée". Cependant, c’est juste la comparaison entre un état (idéal) statique à d’autres. Marshall a traité les marchés "un par un" (d’ou vient l’expression "équilibre partiel") avec l’hypothese "Toutes choses égales par ailleurs" — la condition étant que le reste de l’économie est inchangé ! Cette théorie confond la comparaison des positions alternatives possibles d’équilibre avec l’analyse d’un processus ayant lieu par le temps, c.-à -d. des événements historiques sont présentés dans une image intemporelle. En d’autres termes, le temps comme si le monde réel en ignorait l’existence. Dans le monde réel, tout ajustement prend un certain temps pour s’accomplir et des événements peuvent se produire qui changent l’équilibre. Le processus même de déplacement a un effet sur la destination et donc il n’y a pas de telle chose qu’une position d’équilibre de longue durée qui existe indépendamment du cours que l’économie suit. Les conditions de Marshall d’"un marché à la fois" et de "Toutes choses égales par ailleurs" assurent que le concept du temps est aussi étranger à l’équilibre "partiel" qu’il l’est à l’équilibre "général".
Une grosse partie des sciences économiques traditionnelles est basé sur des théories qui ont peu ou pas de rapport avec la réalité. Le but de la théorie de l’utilité selon les marginalistes était de prouver que le capitalisme était efficace et que chacun tire bénéfice de lui (il maximise l’utilité, dans le sens limité imposé par ce qui est disponible sur le marché, naturellement). C’était ce que la concurrence parfaite a été censé prouver. Mais la concurrence parfaite est impossible. Et comme la concurrence parfaite est elle-même une condition de l’utilité marginale, nous pourrions nous attendre à ce que la théorie soit abandonnée en ce moment. Au lieu de cela, la contradiction a été balayée sous le tapis.
En outre, comme la plupart des religions, les sciences économiques néoclassiques ne peuvent pas être scientifiquement examinées. C’est parce que le modèle parfait de concurrence ne fait aucune prévisions falsifiable en quoi que ce soit. Comme Martin Hollis et Edward Nell le notent :
"En effet l’idée même d’examiner l’analyse marginale est absurde. Parce qu’est-ce qu’un test peut-t-il indiquer ? Les résultats négatifs prouvent seulement que le marché est défectueux. De diverses interprétations peuvent être données ... Mais une interprétation n’est pas possible — que l’analyse marginale ait été réfutée ... Pour généraliser, les constatations des marginalistes sur les effets, si les conditions de la micro-économie positive se tiennent, les conséquences s’avéreront justes, sont des tautologies et leurs conséquences sont des déductions simplement logiques de leur protases ... le modèle n’est pas testable." [Rational Economic Man, p. 34]
En d’autres termes, si une prévision des sciences économiques marginalistes ne se réalise pas, tous ce que nous pouvons en déduire, c’est que la concurrence parfaite n’existait pas. La théorie ne peut pas être contredite, quelque soit la somme des preuves recueillies contre elle. En outre, il y a d’autres techniques utiles qui peuvent être employées pour défendre l’idéologie néoclassique à partir de l’évidence empirique. Par exemple, les sciences économiques néoclassiques prétendent que la production est caractèrisée par des économies d’échelle décroissantes (NDT : la théorie des rendements décroissants) N’importe quelle preuve empirique qui suggère autrement peut être écartée simplement parce que, évidemment, l’echelle n’est pas des assez grande — à la longue, les rendements décroitront avec la taille. De même, le terme "à la longue" peut faire des merveilles pour l’idéologie. Si les bons résultats prétendus d’une politique donnée ne se matérialisent pas sauf pour la classe dirigeante, plutôt que de blâmer l’idéologie, l’échelle de temps peut être la coupable (à la longue, les choses s’avéreront être pour le meilleur — malheureusement pour la majorité, la longue durée n’est pas écoulée encore, mais bientôt ; et jusque-là vous devrez faire des sacrifices pour de futurs gains...). Évidemment, avec une telle "analyse" quelque chose peut être prouvé.
Il n’est pas surprenant que Nicholas Kaldor ait dit : "La théorie d’équilibre de Walrasian [ c.-à -d. générale ] est un système intellectuel fortement développé, très raffiné et élaboré par les économistes mathématiques depuis la deuxième guerre mondiale — une expérience intellectuelle ... Mais elle ne constitue pas une hypothèse scientifique, comme la théorie d’Einstein de relativité ou la loi de newton de l’attraction universelle, du fait que ses conditions initiales sont axiomatiques et non empiriques, et on n’a proposé aucune méthode spécifique par laquelle la validité ou la pertinence de ses résultats pourrait être examiné. Les conditions font des affirmations au sujet de réalité dans leurs implications, mais celles-ci ne sont pas fondés sur l’observation directe, et, selon l’opinion des praticiens de la théorie en tout cas, elles ne peuvent pas être contredites par observation ou expérience." [Op. Cit., p. 416]
Le marginalisme, cependant, malgré ces légers problèmes, a rempli une fonction idéologique valable. Elle a soustrait l’aspect exploitation du système, justifié le fait de donner à des capitaines d’industrie la "liberté" pour fonctionner qu’ils voulaient et dépeint un monde d’harmonie entre les propriétaires des différents facteurs de production. D’ou son acceptation générale dans les sciences économiques. En d’autres termes, celles-ci ont justifié la mentalité "ce qui est profitable est juste" et ont soustrait la politique et l’éthique du champ des sciences économiques. D’ailleurs, la théorie "de concurrence parfaite" (indépendamment de son impossibilité) a permis à des économistes de dépeindre le capitalisme comme optimal, efficace et comme à même de satisfaire nos différents désirs individuels. Et ceci est important, parce que sans l’acceptation de l’équilibre, les transactions du marché n’ont pas besoin de bénéficier à tous. En effet, il peut mener à la tyrannie des chanceux sur les malchanceux, avec la majorité faisant face à une série de choix mornes entre le moins pire d’un groupe de maux. Naturellement, avec l’acceptation de l’équilibre, la réalité doit être ignorée. Ainsi les sciences économiques du capitalisme se trouvent dans un endroit stable.
Au total, le monde considéré par les sciences économiques néoclassiques n’est pas celui dans lequel nous vivons réellement, et ainsi l’application de cette théorie est trompeur et (habituellement) désastreux (au moins pour les "pauvres").
Certains économistes capitalistes prosélytiste du "libre marché" (comme ceux, orientés à droite, de l"’école autrichienne") rejete la notion de l’équilibre complètement et construit un modèle dynamique de capitalisme. Tout en étant bien plus réaliste bien que la théorie néoclassique traditionnelle, cette méthode abandonne la possibilité de démontrer que les résultats du marché sont dans n’importe quel sens une réalisation de l’expression de l’interaction de différents choix. Il n’a aucune manière d’établir le caractère censément stabilisant de l’activité entreprenarial ou son caractère socialement salutaire allégué. En effet, l’activité entreprenariale tend à les les marchés (en particulier marchés du travail) loin des positions d’équilibre (c.-à -d. la pleine utilisation des ressources disponibles) plutôt que vers elles. En d’autres termes, le processus dynamique peut mener à une divergence plutôt qu’à une convergence du comportement et ainsi à un chômage élevé, une réduction de la qualité des choix disponibles pour maximiser votre "utilité" et ainsi de suite. Un système dynamique n’a pas besoin d’être auto-correcteur, en particulier sur le marché du travail, ni de montrer aucun signe d’auto-équilibre (c.-à -d. être sujet à des cycles économiques). Assez ironiquement, les économistes de cette école maintiennent souvent qu’alors que l’équilibre ne peut pas être atteint le marché du travail connaitra le plein emploi dans "le marché libre" ou le capitalisme "pur". Que cette condition en soit une d’équilibre ne semble pas leur causer beaucoup de souci. Ainsi nous trouvons von Hayek, par exemple, arguer que la "cause du chômage ... est une déviation des prix et des salaires de leur position d’équilibre qui s’établirait avec un marché libre et une monnaie stable" et que "la déviation des prix existants de cette position d’équilibre ... est la résultante de l’impossibilité de vendre des partie des ressources de main-d’oeuvre." [New Studies, p. 201] Par conséquent, nous voyons l’habituel agrément de la théorie d’équilibre pour défendre le capitalisme contre les maux qu’il crée même par ceux qui prétendent savoir mieux. Peut-être que ceci un cas de politique expéditive, permettant aux défenseurs idéologiques du capitalisme du marché libre d’attaquer la notion de l’équilibre quand elle à clairement des désaccords avec la réalité mais pouvant y retourner en attaquant, par exemple, les syndicats, les programmes d’assistance sociale et d’autres arrangements qui visent à aider des personnes de la classe ouvrière contre les ravages du marché capitaliste ?
Ces défenseurs du capitalisme soulignent la "liberté" — la liberté des individus de prendre leurs propres décisions. Et qui peut nier que les individus, quand ils sont libres de choisir, sélectionneront l’option qu’ils considèrent la meilleure pour eux-mêmes ? Cependant, ce que cette éloge pour la liberté individuelle ignore est que le capitalisme ramène souvent la liberté de choisir à une alternative entre deux mauvaises solutions à cause des inégalités qu’il crée (par conséquent notre référence à la qualité des décisions disponibles pour nous). L’ouvrier qui accepte de travailler dans un bagne "maximise" sa "utilité" en faisant ainsi — Après tout, cette option est meilleure que mourir de faim — mais seul un ideologue aveuglé par les sciences économiques capitalistes pensera qu’elle ou il est libre ou que sa décision est prise sous la contrainte économique. En d’autres termes, cette idéalisation de la liberté par le marché ignore complètement le fait que cette liberté peut être, pour un grand nombre de personnes, très limitées dans la portée. D’ailleurs, la liberté s’est associée au capitalisme, dans la mesure où le marché du travail tel qu’il est, devient ni plus ni moins la liberté de choisir votre maître. Au total, cette défense du capitalisme ignore l’existence de l’inégalité économique (et ainsi de la puissance) qui réduit la liberté et les occasions des autres (pour une vision plus complête de ceci, voir la section F.3.1). Les inégalités sociales peuvent assurer que les gens finissent par "vouloir ce qu’ils obtiennent" plutôt que "obtenir ce qu’ils veulent" simplement parce qu’ils doivent ajuster leurs espérances et leurs comportements pour se tenir dans les modèles déterminés par des concentrations de puissance économique. C’est en particulier le cas dans le marché du travail, où les vendeurs de la puissance de travail sont habituellement dans une position défavorable une fois comparés aux acheteurs à cause de l’existence du chômage (voir les sections B.4.3, C.7 et F.10.2).
Ce qui nous amène à un autre problème lié au marginalisme, à savoir la distribution des ressources dans la société. La demande du marché est habituellement évaluée en termes de goût, et pas en termes de la répartition du pouvoir d’achat nécéssaire pour satisfaire ces goûts. Ainsi, comme méthode de détermation du prix, l’utilité marginale ignore les différences dans le pouvoir d’achat entre les individus et se base sur la considération fictive que les sociétés sont des personnes (la répartition des revenus est prise en tant que donné). Ceux qui ont beaucoup d’argent pourront maximiser leurs satisfactions bien plus facilement que ceux qui en ont peu. En outre, naturellement, ils peuvent surenchérir sur ceux qui en ont le moins. Si, comme "libertaires" de droite l’ont dit, le capitalisme est "un dollar, une voix", nous savons évidemment quelles sont les valeurs qui vont être reflétées le plus fortement sur le marché. C’est pourquoi les économistes orthodoxes font l’hypothèse commode ’d’une répartition de revenu donnée’ quand ils essayent de montrer que la meilleure répartition des ressources est découle d’un fonctionnement basé sur le marché.
En d’autres termes, sous le capitalisme, ce n’est pas une "utilité" en tant que telle qui est maximisé, mais c’est plutôt une utilité "effective" (habituellement appelée "la demande effective") — notamment celle qui est soutenue avec de l’argent. Le marché du capitalisme (ou plutôt, la classe possedante dans de tels systèmes) accorde de la valeur (c.-à -d. un prix) à des choses selon la demande effective pour elles. "Une demande effective" est le désir des personnes ramené à leur solvabilité. Ainsi, le marché compte les désirs des personnes riches comme plus importants que les désirs des personnes indigentes. Et ainsi le capitalisme ramène la consommation à une satisfaction de l’"utilité" des plus riches aux dépends de ceux qui sont dans le besoin, en les satisfaisant en premier. Ceci ne signifie pas que les besoins des plus nombreux ne seront pas satisfaits (habituellement, mais pas toujours, ils le sont à un certain degré), cela signifie que pour n’importe quelle ressource donnée ceux qui on de l’argent peuvent surenchérir sur ceux qui en ont moins — indépendamment du coût humain. Comme l’économiste libéral Von Hayek le dit, les "ordres spontanés produit par le marché ne s’assurent pas que les besoins considérés comme les plus important par l’opinion générale soient toujours satisfaits avant moins les importants." [The Essential Hayek, p. 258] Ce qui est juste une manière polie de se rapporter au processus par lequel les millionnaires construisent un nouveau manoir tandis que les milliers sont sans foyer ou vivent dans des taudis, donnent de la nourriture de luxe à leurs animaux decompagnie pendant que des humains sont affamés ou quand l’agrobusiness accroit les récoltes d’argent comptant pour les marchés étrangers tandis que les sans-terres meurent de faim (voir également la section I.4.5). Inutile de dire, les sciences économiques de marginaliste justifient cette puissance du marché et ses résultats.
En résumé, les sciences économiques néoclassiques montrent la viabilité d’un système irréel et ceci est traduit en affirmations au sujet du monde dans lequel nous vivons, jusqu’à ce que la plupart des personnes acceptent que la réalité reflète le modèle (plutôt que vice versa, comme il le faudrait mais qui ne se produit pas dans la théorie néoclassique). D’ailleurs, et encore ceci est pire, des décisions politiques seront décrétées, basées sur un modèle qui n’a aucune incidence en réalité — avec des résultats désastreux (par exemple, la gloire et la chute du monétarisme — voit la section C.8). En outre, il justifie (quand il n’ignore pas) les structures hiérarchiques et les inégalités massives dans la richesse et le pouvoir de négociation dans la société, qui se moquent de la liberté individuelle (voir la section section F.3.1 pour plus de détails). Il sert les intérêts de ceux qui ont le pouvoir et la richesse dans la société moderne aussi bien que les objectifs du système commercial, (synonyme de destruction spirituelle, de pollution mondiale) en désapprouvant les facteurs esthétiques, humanitaires et, en effet, humains dans la prise de décision économique. En effet, la seule suggestion que les gens devraient être placés "avant" (ne parlons même pas de "au lieu de") les bénéfices produirait un ajustement. À partir de prémisses faux, le marginalisme finit par nier ses propres idéaux — plutôt que d’être les sciences économiques de la liberté individuelle il devient le moyen de justifier des restrictions et des négations de cette liberté.
Ainsi, si le STV est défectueux, qu’est-ce qui détermine les prix ? Évidemment, à court terme, des prix sont fortement influencés par l’offre et la demande. Si la demande excède l’approvisionnement, le prix monte et vice versa. Ce truisme, cependant, ne répond pas à la question. Les éléments de réponse se trouvent dans la production et dans les rapports sociaux qui s’y produisent. Ceci est discuté dans la prochaine section.
C.1.2 Alors, qu'est-ce qui détermine les prix ?
La clef de la compréhension du niveau des prix se situe dans la comprehension du fait que la production dans le capitalisme a en tant que "seul but ... d’augmenter les bénéfices du capitaliste." [Peter Kropotkin, Kropotkin’s Revolutionary Pamphlets. En d’autres termes, le bénéfice est la force motrice du capitalisme. Une fois que ce fait et ses implications sont compris, la détermination du niveau des prix est simple et la dynamique du système capitaliste se clairifie. Le prix d’un produit capitaliste tendra vers son prix de production sur un marché libre, le prix de production étant la somme des coûts de production plus les taux moyens de bénéfice (le taux moyen de bénéfice, notons-le, dépend de la facilité de l’entrée dans le marché, voir ci-dessous).
Les consommateurs, en faisant des emplettes, sont confrontés aux prix donnés et à un approvisionnement donné. Le prix détermine la demande, basée sur la valeur d’emploi du produit pour le consommateur et à la situation financière de ce dernier. Si l’offre excède la demande, l’offre est réduite (soit que les entreprises réduisent la production ou qu’elle ferment et que le capital se déplace sur d’autres marchés plus profitables) jusqu’à ce qu’un taux moyen de bénéfice soit produit (bien que nous devons souligner une contrainte : il est difficile revenir en arrière sur des décisions d’investissement et ceci signifie que la mobilité peut être réduite, posant des problèmes d’ajustement — tels que le chômage — dans l’économie). Le taux de bénéfice est la quantité de bénéfice divisée par tout le capital investi (c.-à -d. capital constant — moyens de production — et capital variable — les salaires et l’esclavage(NDT : ???)). Si le prix donné produit des bénéfices au-dessus de la moyenne (et ainsi au-dessus du taux moyen de bénéfice), alors le capital essayera de se déplacer des secteurs à faible profits vers ces secteurs à forts taux de profits, l’offre et la concurrence croissante réduisant les prix jusqu’à ce qu’un taux moyen de bénéfice règne à nouveau dans la branche (nous soulignons essayera de car beaucoup de marchés ont des barrières à l’entrée élévées qui limitent la mobilité du capital et ainsi permettent à de grandes entreprises de profiter des taux les plus élevés de bénéfice — voir la section C.4). Ainsi, si le prix a comme conséquence une demande excédant l’offre, ceci cause une augmentation de courte durée des prix et ces bénéfices extra-ordinaires indiquent aux autres capitalistes le mouvement vers ce marché. L’offre en produit tendra à stabiliser au niveau qui donnera un prix produisant le taux moyen de bénéfice (ce niveau dépendant du "degré de monopole" dans un marché — voir la section C.5). Ce niveau de bénéfice signifie que les fournisseurs n’ont aucune incitation pour déplacer le capital dans ou hors de ce marché. N’importe quel changement de ce niveau dans le long terme dépend des changements sur le prix de production du bien (une production inférieure signifiant des bénéfices plus important, indiquant à d’autres capitalistes que le marché pourrait être profitable pour de nouveaux investissements). Comme on le voit, cette théorie (souvent appelée la théorie de la valeur du travail — ou LTV en abrégé) ne nie pas que les consommateurs évaluent subjectivement les marchandises et que cette évaluation peut avoir un effet au court terme sur le prix (qui détermine l’offre et la demande). Beaucoup d’économistes "libertaires" de droite et d’économistes traditionnels affirment que la théorie de la valeur du travail enlève la demande de la détermination du prix. Un des exemples favoris est celui de la "tarte de boue" — si elle nécessite le même travail qu’une tarte aux pommes pour être faite, demandent-ils, elle a sûrement la même valeur ? Ces affirmations sont incorrectes car le LTV se base sur l’offre et la demande et cherche à expliquer la dynamique des prix et ainsi reconnait (et se base en effet sur le fait) que les individus prennent leurs propres décisions en se basant sur leurs besoins subjectifs (En les termes de Proudhon, l’"utilité est la condition nécessaire de l’échange." [System of Economical Contradictions, p. 77])
Ce que le LTV cherche à expliquer est que le prix (c.-à -d. la valeur d’échange) — et un bien ont seulement une valeur d’échange si d’autres les désirent (c.-à -d. leur accorde une valeur d’emploi et ils cherchent à échanger de l’argent ou des marchandises pour les obtenir). Ainsi l’exemple de la "tarte à la boue" est un argument classique sans valeur — la "tarte à la boue" n’a pas une valeur d’échange car il n’a aucune valeur d’utilisation pour d’autres et n’est pas sujet à l’échange. En d’autres termes, si un produit ne peut pas être échangé, il ne peut pas avoir une valeur d’échange (et ainsi de prix). Comme Proudhon l’a dit, "rien n’est échangeable qui ne soit pas utile." [Op. Cit., p. 85]
Le LTV est basé sur l’intuition que sans travail rien ne serait produit et vous devez produire quelque chose avant que vous puissiez l’échanger (ou vous pouvez la voler, comme dans le cas de la terre). Car l’utilité (c.-à -d. valeur d’utilisation) d’un produit ne peut pas être mesurée, le travail est la base de la valeur (d’échange). Le LTV se base sur les besoins objectifs de la production et identifie le rôle principal que le travail joue (directement et indirectement) dans la création des produits. Cependant, ceci ne signifie pas que la valeur existe indépendamment de la demande. Loin de la — comme nous l’avons noté, pour avoir une valeur d’échange, un bien doit être désiré par quelqu’un autre que son fabricant (ou que le capitaliste qui emploie le fabricant), il doit avoir une valeur d’emploi pour lui (en d’autres termes, il est subjectivement évaluée par eux). Par conséquent les ouvriers produisent ce qui a de la valeur (d’utilisation), comme déterminé par la demande, et les coûts de production impliqués par la création de ces valeurs d’emploi aident à déterminer le prix (sa valeur d’échange) avec les niveaux de bénéfice.
Par conséquent le LTV inclut l’élément de vérité de la théorie "subjective" tout en détruisant ses mythes. Parce qu’à la fin, le STV déclare juste que les "prix sont des utilités marginales déterminées ; l’utilité marginale est mesurée par les prix. Les prix ... ne sont plus ou moins que des prix. Les marginalistes, ayant commencé leur recherche dans le domaine de la subjectivité, ont fini par tourner en rond." [Allan Engler, Apostles of Greed, p. 27] Le LTV, d’autre part, se base sur le fait objectif de la production et des coûts (exprimés en temps de travail) s’ensuivant ("La valeur absolue d’une chose, alors, est son coût en temps et en dépenses." [Proudhon, What is Property ?, p. 145]). Les variations de l’offre et de la demande (c.-à -d. le prix du marché) oscillent autour de cette "valeur absolue" (c.-à -d. le prix de production) et ainsi c’est le coût de production d’un produit qui définit finalement son prix, pas l’offre et la demande (qui affecte seulement temporairement son prix sur le marché).
Tandis que le STV est pratique pour décrire le prix des oeuvres d’art (et l’on devrait noter que le LTV peut également fournir une explication pour ceci), il y a peu d’intérêt à avoir une théorie économique qui ignore la nature de la grande majorité des activités économiques de la société. Ce que la théorie de la valeur du travail explique est ce qui, en dehors de l’offre et la demande, détermine réellement le prix dans le capitalisme. Il identifie le prix donné objectivement et l’offre qui se présentent à un consommateur et indique comment la consommation (des "évaluations subjectives") affecte leurs mouvements. Il explique pourquoi un certain produit se vend à un certain prix et pas à un autre — quelque chose que la théorie subjective ne peut pas vraiment faire. Pourquoi un fournisseur "devrait-il changer leur comportement" sur le marché s’il est basé purement sur "des évaluations subjectives" ? Il doit y avoir une indication objective qui guident leurs actions et ceci est trouvé dans la réalité de la production capitaliste. Pour citer à nouveau Proudhon, "si seule l’offre et la demande détermine la valeur, comment pouvons-nous dire ce qui est excessif et ce qui est suffisant ? Si ni le coût, ni le prix du marché, ni les salaires ne peuvent être mathématiquement déterminés, comment est-il possible de concevoir un excédent, un bénéfice ?" [System of Economical Contradictions, p. 114] Par conséquent, "indiquer ... que l’offre et la demande est la loi de l’échange veut dire que l’offre et la demande est la loi de l’offre et de la demande ; ce n’est pas une explication de la pratique générale, mais une déclaration de son absurdité." [Op. Cit., p. 91] La théorie de la valeur du travail reflète ainsi plus exactement la réalité : à savoir, que pour un produit normal, le prix comme l’offre existent avant que les évaluations subjectives puissent avoir lieu et que le capitalisme est basé sur la production du bénéfice plutôt que sur la satisfaction abstraite des besoins du consommateur.
On pourrait arguer que cette théorie des "prix de production" est proche de la théorie néoclassique "d’équilibre partiel". Par certains côtés c’est vrai. Marshall a fondamentalement synthétisé cette théorie à partie de la théorie de l’utilité marginale et de la théorie plus ancienne du "coût de production" que J.S. Mill a lui-même dérivée du LTV. Cependant, les différences sont importantes. D’abord, le LTV n’entre pas dans le raisonnement circulaire lié aux tentatives de dériver l’utilité du prix que nous avons indiqué ci-dessus. En second lieu, il argue du fait que le loyer, le bénéfice et l’intérêt sont le travail impayé des ouvriers plutôt que d’être une "récompense" aux propriétaires d’être des propriétaires. Troisièmement, c’est un système dynamique dans lequel les prix de production peuvent et doivent changent lorsque des décisions économiques sont prises. Quatrièmement, il peut facilement rejeter l’idée "de la concurrence parfaite" et donner la vision d’une économie marquée par des barrières à l’entrée et la difficulté de revenir en arrière sur des décisions d’investissement. Et, pour finir, les marchés du travail n’ont pas besoin de s’éclaircir à la longue. Étant donné que les sciences économiques modernes ont finit par abandonné la mesure de l’utilité, cela signifie que dans la pratique (si ce n’est pas dans la rhétorique) le modèle néoclassique a rejeté la théorie de l’utilité marginale de la partie synthèse de la valeur et est retourné, fondamentalement, à l’approche (LTV) classique — mais avec les différences importantes qui enlève à cette version son côté critique et se nature dynamique.
Inutile de le dire, le LTV n’ignore pas les objets naturels comme les pierres précieuses, les nourritures sauvages, et l’eau. La nature est une vaste source de valeurs d’emploi que l’humanité doit utiliser afin de produire d’autres, différentes, valeurs d’emploi. Si vous préferez, la terre est la mère et le travail le père de la richesse. Il est parfois dit que la théorie de valeur de travail implique que les objets naturels ne devraient avoir aucun prix, puisqu’il n’est besoin d’aucun travail pour les produire. Ceci, cependant, est faux. Par exemple, les pierres précieuses ont de la valeur parce qu’il est besoin d’une quantité énorme de travail pour les trouver. S’il était facile de les trouver, comme le sable, elles seraient bon marché. De même, les nourritures sauvages et l’eau ont une valeur selon le travail nécessaire pour les trouver, les rassembler, et les traiter dans un secteur donné (par exemple l’eau dans les endroits aride a davantage de "valeur" que l’eau près d’un lac).
La même logique s’applique à d’autres objets naturels. Si l’il n’est besoin de pratiquement aucun effort de les obtenir — comme l’air — ils auront peu ou pas de valeur d’échange. Cependant, plus les efforts pour trouver, rassembler, épurer, ou tout autre processus applicable pour l’utiliser sont important, plus la valeur d’échange qu’ils auront relativement à d’autres marchandises sera importante (c.-à -d. leurs prix de production seront plus élevés, conduisant à un prix du marché plus élevé).
La tentative d’ignorer la production implicitement présente dans le STV vient d’un désir de cacher la nature exploitative du capitalisme. Par la concentration sur les évaluations "subjectives" des individus, ces individus sont soustraits de l’activité économique réelle (c.-à -d. de la production) et ainsi la source de bénéfices et de puissance dans l’économie peut être ignorée. La section C.2 (D’où viennent les bénéfices ?) indique pourquoi l’exploitation du travail dans la production est la source des bénéfices, et non pas l’activité sur le marché. Naturellement, le pro-capitaliste arguera du fait que la théorie de la valeur du travail n’est pas universellement acceptée dans les sciences économiques traditionnelles. Comme c’est vrai ; mais ceci suggère difficilement que la théorie est erronée. Après tout, il aurait été facile de "prouver" que la théorie démocratique était "erronée" dans l’Allemagne nazie simplement parce qu’elle n’a pas été universellement acceptée par la plupart des conférenciers et chefs politiques d’alors. Sous le capitalisme, de plus en plus de choses sont transformées en produits — commme les théories économiques et les emplois des économistes. Etant donné un choix entre une théorie qui argue du fait que les bénéfices, les intérêts et les loyers sont du travail impayé (c.-à -d. de l’exploitation) et une théorie qui affirme qu’ils sont des "récompenses" normales pour des services, qui pensez-vous que les fortunés sponsoriseront ?
C’était le cas avec la théorie de la valeur du travail. Depuis Adam Smith, les radicaux avaient employé le LTV pour la critique du capitalisme. Les économistes classiques (Adam Smith et David Ricardo et leurs successeurs comme J.S. Mill) ont argué du fait que, à la longue, les produits étaient échangés proportionnellement au travail nécéssité pour les produire. Ainsi la bourse du commerce a bénéficié à toutes les parties qui recevaient une quantité équivalente au travail qu’elles avaient effectué. Cependant, cela laissait la nature et la source du profit capitaliste sujets à discussion, discussion qui bientôt se répandit à la classe ouvrière. Longtemps avant que Karl Marx (la personne la plus associée au LTV) ait écrit sa (très) fameuse oeuvre Le Capital, les socialistes Ricardien comme Robert Owen et William Thompson et les anarchistes comme Proudhon employaient le LTV pour présenter une critique du capitalisme, l’exposant comme étant basé lors de l’exploitation (l’ouvrier, en fait, n’a pas reçu dans les salaires l’équivalent de la valeur qu’il a produit et ainsi le capitalisme n’est pas basé sur l’échange de choses équivalentes). Aux Etats-Unis, Henry George les employait pour attaquer la propriété privée de la terre. Quand les sciences économiques marginalistes sont survenues, elles ont été rapidement saisies comme manière de contrer l’influence radicale. En effet, les successeurs d’Henry George arguent du fait que les sciences économiques néoclassiques ont été développées principalement pour contrecarrer ses idées et son influence (voir The Corruption of Economics by Mason Gaffney and Fred Harrison).
Ainsi, comme remarqué ci-dessus, les sciences économiques marginalistes ont été prises telle quelles, indépendamment de leurs mérites en tant que science, simplement parce qu’elles ont sorti le politique hors de l’économie politique. Avec l’apparition du mouvement socialiste et des critiques d’Owen, de Thompson, de Proudhon et de beaucoup d’autres, la théorie de valeur de travail a été considérée comme trop politique et donc dangereuse. Le capitalisme ne pouvait plus être vu comme étant basé sur l’échange de quantité de travail équivalente. A la place, il a été vu comme étant basé sur l’échange d’utilités équivalente. Mais, comme indiqué (dans la dernière section) la notion de l’utilité équivalente a été rapidement délaissée tandis que la superstructure construite sur elle devenait la base des sciences économiques capitalistes. Et sans théorie de valeur, le les sciences économiques capitalistes ne peuvent pas montrer que le capitalisme aura comme conséquence l’harmonie, la satisfaction des besoins de l’individu, la justice dans l’échange ou la répartition efficace des ressources.
Un dernier point. Nous devons souligner que tous les anarchistes ne soutiennent pas la LTV. Kropotkin, par exemple, n’était pas d’accord avec elle. Il a considéré l’utilisation socialiste du LTV comme prenant "les définitions metaphysiques des économistes universitaires" pour critiquer le capitalisme en utilisant ses propres définitions et ainsi, comme les sciences économiques capitalistes, elles n’étaient pas scientifiques[Evolution and Environment, p. 92]. Cependant, son rejet du LTV n’a pas impliqué que Kropotkin n’a pas considéré le capitalisme comme exploitatif. Loin de la. Comme chaque anarchiste, Kropotkin a attaqué l’"appropriation du produit du travail humain par les propriétaires du capital," voyant ses racines dans le fait que des "millions d’hommes [ et de femmes ] n’ont littéralement rien pour vivre sur le moment, à moins qu’ils ne vendent leur main-d’oeuvre et leur intelligence à un prix qui rendront le bénéfice net du capitaliste et ’la valeur en surplus’ possibles." [Op. Cit., p. 106] Nous discutons des bénéfices plus en détail dans la section C.2 (D’ou viennent les profits ?).
Le rejet de Kropotkin du LTV est basé sur le fait que, dans le capitalisme, la "valeur dans l’échange et le travail nécessaire ne sont pas proportionnels entre eux" et ainsi le "travail n’est pas la mesure de la valeur."[Op. Cit., p. 91] Ce qui est, naturellement, vrai sous le capitalisme. Comme Proudhon (et Marx) le disaient, sous le capitalisme (à cause de l’existence du bénéfice, du loyer et de l’intérêt du capitaliste) le prix ne pourrait pas être proportionnel au travail moyen requis pour produire un produit ("là où le travail n’a pas été socialisé, — c’est-à -dire, partout où la valeur n’est pas synthétiquement déterminée, — il y a des irrégularités et de la malhonnêteté dans l’échange." [Proudhon, Op. Cit., p. 128]) C’est seulement quand le taux de bénéfice est zéro que les prix pourraient refléter la valeur du travail (ce qui est, naturellement, ce que Proudhon et Tucker désirait — "Le socialisme ... étends sa fonction ["que le travail est la vraie mesure du prix" ] à la description de la société telle qu’elle devrait être, et la découverte des moyens de la faire être ce qu’elle devrait." [Tucker, The Individualist Anarchists, p. 79]). Par conséquent, Kropotkin est dans le vrai quand il déclare que "sous le système capitaliste, la valeur dans l’échange n’est plus mesurée par la quantité de travail nécessaire." [Op. Cit., p. 91]
Cependant, ceci ne signifie pas que le LTV n’est pas pertinent pour analyser l’économie capitaliste. Plutôt, il porte à notre attention le fait que sous le capitalisme le travail est, essentiellement, le régulateur du prix, non sa mesure. "l’idée qui a été entretenu jusqu’ici de la mesure de valeur," a dit Proudhon, "alors, est inexacte ; l’objet de notre enquête n’est pas le niveau de la valeur, comme il a été dit tellement souvent et tellement bêtement, mais plutôt la loi qui règle les proportions des divers produits avec la richesse sociale ; parce que de la connaissance de cette loi dépend la montée et la chute des prix." [System of Economical Contradictions, p. 94] Ainsi l’argument de Kropotkin ne mine pas le LTV en tant que tel. Dépouillé des bagages metaphysical que beaucoup (en particulier les marxistes) ont placés sur le LTV (et correctement attaqué comme non scientifique par Kropotkin), c’est essentiellement un outil méthodologique, un moyen d’étudier les aspects principaux du capitalisme — notamment le travail salarié et les conflits liés à lui au moment de la production — à un niveau élevé d’abstraction. Ainsi c’est un outil explicatif et met en valeur une catégorie explicative, un moyen de comprendre la dynamique du capitalisme.
Par conséquent, plutôt que d’être l’idée brute que la "valeur d’échange" est égale au prix, le LTV est principalement un moyen d’analyse. Ceci peut être vu par notre utilisation de la "valeur de production" plutôt que de la valeur (d’échange) dans notre description de la façon dont la théorie fonctionne. Le LTV focalise l’analyse sur le procédé de production et dirige ainsi correctement nos investigations sur la façon dont le capitalisme fonctionne à ce qui se passe dans la production, aux relations de l’autorité dans le lieu de travail capitaliste, à la lutte entre la puissance du patron et la liberté des ouvriers, à la lutte pour qui commande le processus de production et comment l’excédent produit par des ouvriers est divisé (c.-à -d. combien reste dans les mains de ceux qui l’ont produit et combien est approprié par les capitalistes). Par conséquent, les affirmation selon lesquelles les prix dérivent des valeurs et ainsi que le LTV est périmé indique une confusion entre le rôle explicatif du LTV et le monde réel des prix et des profits. Le LTV nous rappelle que la production vient avant et qu’elle est ainsi à la base de l’échange et que ce qui se produit au moment de la production influence directement ce que se produit dans l’échange. Diminuer le temps de travail direct et indirect requis pour la production diminuera le coût d’un produit et ainsi réduira son prix de production. Ainsi la montée et la chute des prix et des bénéfices est le résultat de changements des relations de valeur (c.-à -d. des coûts objectifs de la main-d’oeuvre de production — valeur du temps de travail) et ainsi l’utilisation du LTV comme outil explicatif est valide.
En d’autres termes, la théorie de la valeur du travail est simplement un bon dispositif heuristique d’analyse qui donne une vision de la façon dont des prix sont formés plutôt que les prix en tant que tels. Dans la pratique, les prix de production dépendent des salaires et ceux-ci reflètent des valeurs de temps de travail plutôt que d’être des valeurs de temps de travail.
Ainsi Kropotkin avait raison — jusqu’à un certain point. Sa critique du LTV est correcte pour les versions qui prétendent que le prix d’"équilibre" est égal à la valeur (d’échange) d’un bien. Il était correct de noter que sous le capitalisme ceci se produit rarement. Ce qui signifie que notre utilisation du LTV est simplement celle d’un outil explicatif, un moyen de regarder l’aspect principal du capitalisme — notamment le procédé de production qui crée les choses qui ont une valeur d’utilisation pour d’autres et sont alors échangées. La production vient d’abord et ainsi nous devons d’abord commencer là pour comprendre la dynamique du capitalisme. Ne pas faire ainsi, comme le fait le STV, mènera votre analyse dans une voie sans issue et ignorera l’aspect fondamental du capitalisme — le travail salarié, les structures d’autorité dans la production et l’exploitation du travail qu’une telle oppression produit.
En effet, l’argument de Kropotkin est reflété dans la perspective des "prix de production" décrite ci-dessus pendant que nous nous concentrons les prix plutôt que sur les "valeurs." Nous rejetons les abstractions metaphysiques souvent liées au LTV et nous nous concentrons plutôt sur de vrais phénomènes, tel que les prix, les bénéfices, la lutte de classe et ainsi de suite. Une telle perspective aide à baser notre critique de capitalisme sur ce qui se produit dans le vrai monde plutôt que dans les royaumes de l’abstraction. Car comme nous l’avançons dans la section H.3.2, la concentration de Marx sur la valeur (c.-à -d. le niveau abstrait de l’analyse) l’a incité à ignorer le rôle de la lutte de classe dans le capitalisme et son effet sur les bénéfices (avec de mauvais résultats pour sa théorie et le mouvement qu’il a inspiré).
C.1.3 Quoi d'autre détermine les niveaux de prix ?
Comme indiqué dans la dernière section, le prix d’un produit capitaliste, dans le long terme, est égal à son prix de production, qui détermine à son tour l’offre et la demande. Si la demande ou l’offre changent, ce que naturellement ils peuvent faire, comme les valeurs d’usage des consommateurs changent et de nouveaux moyens de production sont créés et d’autres disparaissent, cela aura un effet à court terme sur les prix, mais le prix moyen de production est le prix autour duquel un produit capitaliste se vend. Ainsi c’est le coût de production qui règle finalement le prix des produits. En d’autres termes, "les relations du marché sont régies par les relations de production."[Paul Mattick, Economic Crisis and Crisis Theory, p. 51] Comme Proudhon l’a dit :
"Ainsi la valeur change, et la loi de la valeur est constante, de plus, si la valeur est sujette à variation, c’est parce qu’elle est régie par une loi dont le principe est essentiellement inconstant, — notamment, le travail mesuré par la temps." [Op. Cit., p. 100]
Cependant, la quantité de temps et d’efforts dépensés en produisant un produit particulier n’est pas le facteur essentiel dans la détermination de son prix sur le marché. Ce qui compte sont les coûts (y compris la quantité de temps de travail) qu’il a en moyenne pour produire ce type de produit, au moment où le travail est effectué avec une intensité moyenne, avec les outils typiquement utilisés et des niveaux de compétence moyens. La production des produits qui tombe au-dessous de telles normes, par exemple en utilisant une technologie désuète ou une intensité inférieure à la moyenne de travail, ne permettra pas au vendeur d’augmenter le prix du produit pour compenser sa production inefficace, parce que son prix est déterminé sur le marché par les conditions moyennes (et ainsi les coûts moyens) de production, plus les niveaux moyens de bénéfice exigés pour arriver au taux moyen de bénéfice sur le capital investi. D’autre part, employer les méthodes de production qui sont plus efficaces que la moyenne — c.-à -d. qui permettent à plus de produits d’être produits avec moins de travail — permettra au vendeur de récolter plus de bénéfices et/ou d’abaisser le prix au-dessous de la moyenne, et de capturer ainsi plus de part de marché, qui forcera par la suite d’autres producteurs à adopter la même technologie afin de survivre, et ainsi diminuer le prix de production du marché de ce type de produit. De cette façon, les avances qui réduisent le temps de travail se traduisent en valeur d’échange réduite (et ainsi en prix réduits), de ce fait montrant la fonction de régulation du temps de travail (et indiquant l’utilité du LTV comme outil méthodologique).
De même, le LTV fournit également une explication à pourquoi les ressources communes dans un secteur deviennent plus valables dans d’autres (par exemple, le prix de l’eau pour une personne dans un désert serait bien plus élevé que pour quelqu’un à côté d’un fleuve). À court terme, le propriétaire de l’eau dans le désert peut fixer un prix très haut pour ceux qui la veulent simplement parce qu’elle est rare et la quantité de travail exigée pour trouver une source alternative serait énorme (nous ignorerons l’éthique de fixer des prix élevés pour des gens dans le besoin pour le moment, de même que les sciences économiques marginalistes qui dépeignent de telles situations — que la plupart des personnes classeraient intuitivement comme exploitatives — comme "un juste échange"). Mais si de tels bénéfices exceptionnels peuvent être maintenus pendant de longues périodes, alors d’autres seraient tentés de venir faire de la concurrence. Si une demande régulière d’eau existait dans cette région, de fait la concurrence entraînerait alors une réduction du prix de l’eau autour du prix moyen exigé pour le rendre disponible (ce qui explique pourquoi les capitalistes désirent réduire la concurrence par l’intermédiaire de l’utilisation des lois de copyright, des brevets et ainsi de suite — voyez que la section section B.3.2 — aussi bien que par la taille de l’entreprise, ses parts de marché et sa puissance croissante — voir la section section C.4). Pour récapituler, comme le coût de production pour un produit est une donnée, qui peut seulement indiquer si un produit donné "est évalué" suffisament par des consommateurs pour justifier une production accrue. Ceci signifie que le "capital se déplace des industries relativement stagnante vers des industries se développantes rapidement ... Le bénéfice supplémentaire, au-dessus du bénéfice moyen, gagné à un niveau des prix donné disparaît encore, cependant, avec l’afflux du capital de venant des industries peu profitables vers les industries très profitable," ainsi fait augmenter l’offre et réduire les prix, et le profit également. [Paul Mattick, Op. Cit., p. 49]
Ce processus d’investissement du capital d’équipement, et la concurrence résultante, est le moyen par lequel les prix du marché tendent vers les prix de production sur un marché donné. Le bénéfice et les réalités du procédé de production sont les clefs de la compréhension des prix et comment ils affectent (et sont affectés près) l’offre et la demande.
Pour finir, nous devons souligner que déclarer que le prix du marché tend vers le prix de production n’est pas suggérer que le capitalisme soit à l’équilibre. Loin de là . Le capitalisme est toujours instable, puisque "grossissant hors de la concurrence capitaliste, pour intensifier l’exploitation ... les relations de la production ... [ sont ] dans un état de transformation perpétuelle, qui se manifeste en changeant les prix relatifs des marchandises sur le marché. Par conséquent le marché est sans interruption en déséquilibre, bien qu’avec différents degrés de sévérité, de ce fait donnant lieu, par son approche occasionnelle de l’état d’équilibre, à l’illusion d’une tendance vers l’équilibre."[Paul Mattick, Op. Cit., p. 51]
Par conséquent, l’innovation due à la lutte de classe, à la concurrence, ou à la création des marchés, a un effet important sur les prix du marché. C’est parce que l’innovation change les coûts de production d’un produit ou crée de nouveaux marchés très profitables. Tandis que l’équilibre ne peut être atteint dans la pratique, ceci ne change pas le fait que le prix détermine la demande, puisque les consommateurs rencontrent (habituellement) des prix comme valeurs objectives déjà donnée quand ils font des achats et prennent des décisions basées sur ces prix afin de satisfaire à leurs besoins subjectifs. Ainsi le LTV identifie que le capitalisme est un système existant dans le temps, avec un futur incertain (un futur influencé par beaucoup de facteurs, y compris la lutte de classe) et, de par sa nature, dynamique. En outre, à la différence des prix néoclassiques "d’équilibre de longue durée", le LTV n’affirme pas que les marchés du travail se dégageront ou qu’un changement sur un de marché n’aura aucun effet sur d’autres. En effet, le marché du travail peut voir un chômage élevé car ceci aide à maintenir des niveaux de bénéfices en maintenant la discipline — par l’intermédiaire de la crainte du chomage — sur le lieu de travail (voir la section C.7). Ni ne maintient que le capitalisme sera stable. Comme l’histoire du capitalisme "existant actuellement" le montre, le chômage est toujours présent et le cycle économique existe (dans des sciences économiques néoclassiques de telles choses ne peuvent pas se produire que la théorie suppose que tout les marchés se dégageront et que les récessions sont impossibles).
D’ailleurs, le LTV indique la source de cette instabilité — notamment "l’idée contradictoire de la valeur, tellement bien montrée par la distinction inévitable entre la valeur d’usage et la valeur dans l’échange." [Proudhon, Op. Cit., p. 84] C’est en particulier le cas avec le travail, car la valeur d’échange du travail (son coût, c.-à -d. les salaires) est différente de sa valeur d’utilisation (c.-à -d. ce qu’il produit réellement pendant un jour ouvrable). Comme nous allons le voir dans la prochaine section, cette différence entre la valeur d’utilisation du travail (son produit) et son valeur d’échange (son salaire) est la source du bénéfice capitaliste (nous indiquerons dans la section C.7 la façon dont cette distinction influence le cycle économique — c.-à -d. l’instabilité dans l’économie).